- MP3 - 2.7 Mio

« râmû massîrî ilâ jurbel… » ou le triomphe total et définitif du serviteur privilégié du prophète.
En cette année 1433 de l’Hégire, le 18 safar, jour où l’on célèbre le Maggal de Touba, coïncidera dans le calendrier julien-grégorien au jeudi 12 janvier 2012.
Traditionnellement, c’est le lendemain du Maggal que la famille de Serigne Touba, sous le magister du Khalife Général, reçoit les hommages du pays et du reste du monde dans le cadre d’une cérémonie officielle. A l’occasion de celle-ci, un message est adressé par le Khalife ou son représentant à l’assistance composée de dignitaires mourides, disciples, invités, autorités gouvernementales, délégations représentants les familles religieuses du pays, corps diplomatique, etc. Habituellement, ce message, parce qu’il est très fort, est très attendu, et, par médias interposés, s’adresse, en réalité, au monde entier. Cette année donc, cette cérémonie aura lieu le vendredi 13 janvier 2012.
Or, l’historiographie du Mouridisme, toutes sources confondues, nous enseigne que c’est entre le 13 et le 16 janvier 1912 que KHADIMU RASSOUL, LE SERVITEUR DU PROPHETE (PSL), a effectué son célèbre déplacement qui le mena de Thiéyène, situé au Jolof, à Diourbel, capitale du Baol, après sept années d’un premier exil au Gabon, suivies de quatre années d’un deuxième exil en Mauritanie et de cinq autres années de résidence surveillées à Thiéyène même.
C’est dire que dans le calendrier julien-grégorien, celui de référence de ceux qui ont privé de liberté le Fondateur du Mouridisme, le centenaire du retour de celui-ci dans le Baol, coïncidera donc, jour pour jour, avec la journée de la cérémonie officielle lors de laquelle l’œuvre de Serigne Touba fait l’objet de toutes les attentions.
Quand on sait que le Maggal commémore le départ du Cheikh vers l’exil au Gabon, lequel avait été décrété par le Conseil Privé lors de sa séance du 05 septembre 1895, « par mesure d’éloignement » afin de tuer dans l’œuf le Mouridisme naissant ; quand on se souvient que le transfèrement du Cheikh de Thièyene à Diourbel fut décidé par l’administration coloniale « par mesure politique pour contrer sa popularité et son influence grandissante » ; et que l’on se rende compte, qu’aujourd’hui, - alors même que la colonisation a pris fin depuis plus d’un demi siècle, - l’héritage du Cheikh vient de passer des mains de la génération de ses propres fils à celle de ses petits fils, sans heurts dans la succession, ni déperdition dans le contenu ; on ne peut que s’émerveiller encore une fois, à l’occasion de ce centenaire, devant le triomphe de ce « Jihadiste » solitaire, sans troupes ni armements, face aux représentants de l’une des plus grande puissance politico militaire de l’époque : la France coloniale.
La victoire du Pacifisme de Sëriñ Tuubaa apparait totale et son efficacité historique encore une fois illustrée, si bien que, cette coïncidence, clin d’œil de l’Histoire, ne peut que susciter un émerveillement de la part de toute personne qui s’intéresse à l’œuvre de Boroom Tuubaa.
Mais quand on décide, après avoir pris acte du caractère symbolique de cette coïncidence, d’aller plus loin que l’émerveillement ponctuel, - en s’intéressant, dans une entreprise de recherche et d’analyse, aux causes exotériques comme ésotériques du retour à Njaareem , - on découvre au moins deux aspects inhérents à cette étape qui font d’elle un moment exceptionnel dans l’itinéraire du SERVITEUR DU PROPHETE : le premier est son rôle prépondérant dans le parachèvement de l’édification du Mouridisme et le second étant sa signification mystique telle que le Cheikh l’a suggérée dans sa célèbre déclaration communément désigné par les deux mots arabes « râmû massîrî » avant de l’expliciter dans une typologie qui nous renseigne sur les différentes étapes de son ascension spirituelle.
Il s’agit dans les lignes qui suivent, de mettre en exergue ces deux aspects en montrant comment l’étape de Diourbel fut le tremplin sociohistorique depuis lequel l’édifice du Mouridisme fut parachevé par son fondateur en personne avant d’être mis sur les rails de la pérennisation par le premier Khalife serigne Moustapha Mbacké ; mais aussi de rappeler cette signification ésotérique de l’étape de Diourbel dans l’ascension spirituelle du Cheikh telle que lui-même nous l’a enseignée.
Cette dimension ésotérique, sans laquelle on ne saurait prendre toute la mesure du panache avec lequel le Cheikh a triomphé de l’administration coloniale sur tous les plans, confère à cette coïncidence dans les dates une aura mystique aux yeux de tout musulman qui garde à l’esprit l’immanence de la Volonté divine en toute chose aussi infime soit-elle.
En effet si la PUISSANCE du TRES HAUT est la qualité qui LUI permet l’existentiation ou la résorption de tout ce qui est possible, c’est bien par Sa VOLONTE, cet autre attribut dont IL a l’exclusivité, que s’opère la détermination des possibles existants. Autrement dit, c’est la VOLONTE DIVINE, comme nous le rappelle le Cheikh lui-même dans « Les Dons du TRES SAINT … » qui attribue à toute créature son existence, sa mesure existentielle, son aspect, son époque, son lieu ainsi que sa direction de localisation par opposition, aux contraires, respectivement, de chacune de ces six catégories. C’est dire qu’en réalité, il n y a de coïncidence en dehors de la VOLONTE divine.
C’est dans cette perspective d’approfondissement que je me fais le devoir, en ma qualité de mouride, d’inscrire la présente contribution, dont la publication à une dizaine de jours du Maggal, est faite à dessein dans l’espoir de susciter d’autres réactions dans le cadre des nombreux débats, émissions de télévision, articles de presse qui marquent depuis quelques années les préparatifs du 18 safar.
Bien entendu, le but ultime étant, outre celui strictement religieux de « barkeelu » de ma part, d’encourager des échanges fructueux sur les enseignements du Cheikh dont l’utilité est manifeste dans le contexte socio politique dans lequel notre pays s’agite et s’interroge en ce moment comme rarement il lui est arrivé de le faire dans son histoire.
DIOURBEL : L’ETAPE DU PARACHEVEMENT
Une mise en pratique populaire de l’éthique mouride du travail par La conquête des Terres Neuves.
L’étape de Diourbel dura 15 ans, de 1912 à 1927. Elle a donc été la plus longue période que LE SERVITEUR DU PROPHETE ait eu à passer dans un lieu de résidence sans interruption depuis la fondation du Mouridisme vers 1883. Ultime étape de son existence terrestre, elle lui a permis de consolider et de parachever son œuvre par de multiples actes concrets qui ont fini par faire du Mouridisme ce qu’il est et, surtout, ce qu’il doit rester ad aeternam quant à sa quintessence et ses structures fondamentales.
Un des thèmes autour desquels s’est structurée l’œuvre de Boroom Tuubaa est celui du travail considéré comme partie intégrante du culte que l’homme doit rendre à son Seigneur dont il est le vicaire sur cette Terre. Dans cette optique, Diourbel fut le quartier général à partir duquel LE SERVITEUR DU PROPHETE mit en pratique, à une échelle démographique beaucoup plus grande qu’auparavant, ce que d’aucuns appellerons la doctrine économique mouride , à travers un vaste mouvement dit de « La conquête des Terre Neuves. » Celui-ci, marqué par la fondation d’une multitude de dara dont certaines évolueront pour devenir des villages mourides, fut une parfaite illustration du début d’un élan vers la pérennisation du Mouridisme.
Pour s’en convaincre, examinons d’abord les faits de façon objective tels qu’ils ont été décrits par Paul Pélissier (1966), en essayant de trouver des réponses aux questions suivantes : quand, où, comment et dans quelles conditions la conquête des terres neuves a t- elle été menée ?
La participation du Mouridisme dans la conquête des Terres Neuves s’est déroulée en deux phases. La première a véritablement commencé en 1907, alors que le Cheikh était en résidence surveillée à Thiéyène. Elle prendra un nouvel essor dès 1912 et se poursuivra jusqu’en 1927, année de la disparition du Cheikh. La seconde sera donc dirigée par son premier khalife de 1932 à 1945. Seule la description de la première phase sera rapportée dans le cadre de cette contribution en guise d’illustration. Pour aller vite tout en restant objectif, j’ai choisi de privilégier une série de citations directes de Pélissier essentiellement, auteur sans aucuns liens affectifs connus avec le Mouridisme. Le lecteur intéressé lira avec intérêt, David (1980) et Copans (1988)
Selon Pélissier : « …..la première période de la colonisation mouride semble s’être déroulée en marge de toute initiative administrative directe, sous la seule responsabilité des chefs religieux et avec les seuls moyens dont ils disposent »
Cette première phase eut pour cadre géographique de manière quasi exclusive, le berceau même du Mouridisme. En effet, comme l’écrit Pélissier « C’est en particulier dans l’ancienne province du Là, autour de Mbacké et de Touba, que le fils ainé d’Ahmadou Bamba, Mamadou Moustapha crée, entre 1914 et 1927, une véritable nébuleuse de villages nouveaux, tandis que le frère préféré du Khalife, Ibra Fati, défriche et peuple un peu plus au nord, à partir de Mbacké-Cayor, puis de Darou Mousty qu’il a fondé en 1912, les forêts séparant naguère le Cayor du Baol. »
En ce qui concerne, de façon plus précise, la localisation géographique du phénomène, elle semble « pouvoir être fixées schématiquement dans deux zones privilégiées : d’une part sur les confins orientaux du Cayor et dans la partie centrale du Baol, au nord de Diourbel ; d’autre part, le long de la voie ferrée de Diourbel à Guinguinéo et à Kafrine
Le mouvement va s’intensifier grâce à l’arrivée du chemin fer accompagnée de forage de puits.
Pélissier écrit « C’est ainsi que l’arrivée du chemin de fer à Gossas en 1909, à Guinguinéo en 1910, à Mbirkilane en 1012, à Kaffrine et à Koungheul en 1914, est immédiatement suivie de l’installation de colons qui sont en majorité des mourides. »
De façon plus précise, Pélissier décrit l’appropriation que les mourides font du chemin de fer en ces termes :
« En fait, chaque station semée par le rail tous les 25 ou 30 Km, est transformée en village puis en escale, par des disciples d’Ahmadou Bamba. A partir de la voie ferrée, ceux-ci n’hésitent pas à se lancer dans la haute brousse du Ferlo méridional, à l’est et au nord du chemin de fer. Par exemple, partant de Guinguinéo, en direction de l’est-nord-est, ils fondent, dès 1914, Pétègne, Mboss mouride, NBoulogne-Diawandou, Diamal Moussa, (…). Chaque station de la voie ferrée est ainsi le point de départ d’un chapelet de villages semés en pleine forêts. » p 305
Cette participation du Mouridisme, lorsqu’elle est soumise à une analyse plus pointue, fournit des renseignements fort intéressants sur l’œuvre de Sëriñ Tuubaa.
Nature, qualité et efficacité de la réponse mouride face à la dislocation sociale.
En interrogeant ainsi l’histoire du Mouridisme sous l’angle de l’étape de Diourbel, on met en exergue le fait que les rapports entre la confrérie et le travail remontent à la naissance de celle-ci et sont l’expression même de l’œuvre de Serigne Touba en personne. On voit bien que l’implication du Mouridisme dans la conquête des Terre Neuves, loin d’être accidentelle, procède d’une volonté autonome et intrinsèque à l’enseignement du Cheikh.
Outre cette consubstantialité entre Mouridisme et Travail, l’étape de Diourbel nous renseigne également sur la nature et la qualité de l’influence de la confrérie par rapport à celle des autres facteurs en action. Ainsi, nous savons que la présence du Mouridisme a été déterminante et la qualité et la nature de son influence parfaitement identifiables, même si l’extension de l’espace agricole sur le flanc oriental du bassin de l’arachide est le résultat de la convergence de trois facteurs : l’implication du Mouridisme ; le succès de la culture de l’arachide et la pénétration des voies de communications notamment la pose du rail sur la ligne Dakar-Kayes.
En effet, même si la participation de cultivateurs non mourides est attestée, « cette œuvre d’annexion au domaine agricole d’un territoire jusque là vide, comme le dit Pélissier, est essentiellement une entreprise mouride. » p303
Nous savons également que ce sont des caractéristiques propres à la confrérie qui sont à la base du succès de ce déploiement spatial sans précédent dans le pays comme le précise Pélissier.
« Les conditions dans lesquelles certains villages nouvellement créés doivent affronter en particulier le problème de l’eau, transformèrent parfois la tâche des pionniers en une aventure héroïques dont seuls rendent compte la foi enthousiaste, la solidarité et l’organisation des mourides. « p 304
Mieux, il ressort de l’analyse des informations fournies par les chercheurs que l’influence du Mouridisme telle qu’elle s’est exprimée à cette époque, révélait déjà la présence d’un esprit d’innovation, d’une véritable pertinence historique par rapport aux problèmes sociopolitiques de l’époque mais aussi celle d’un opportunisme salutaire.
En effet, comment ne pas reconnaitre un esprit d’innovation dans le phénomène de la colonisation agricole mouride lorsqu’on sait, comme le soulignent les chercheur, que jusqu’à la 1ère guerre mondiale, les Wolofs et les Sérère se sont cantonnés géographiquement dans leurs vieux pays bordés sur le flanc oriental par les forêts du Ferlo. Alors que ces derniers constituaient un domaine démesuré, presque vide d’hommes, ils n’avaient fait, avant la conquête des Terres Neuves, l’objet d’aucune emprise, ni de la part des royaumes traditionnels, ni de la part de leurs paysans.
Il faut dire que si les aristocraties locales ont manqué d’ambitions politiques, les paysans quant à eux redoutaient le manque d’eau et la présence de bêtes sauvages contrairement aux « takk der » mourides qui n’ont reculé devant aucun obstacle. Plus surprenant encore est la fonction d’anticipation que la colonisation agricole a joué et que les études mettent à l’actif du Mouridisme : la croissance démographiques naturelle aurait, de toute façon, obligé les paysans à essaimer, ce qui aurait rendu nécessaire une conquête du Ferlo.
Enfin, la pertinence historique de la colonisation agricole mouride est d’une évidence absolue. En effet, le mouvement survint à un moment où, plus qu’à un aucun autre moment de leur histoire, les populations avaient besoin de se remobiliser suite à la dislocation sociale qui suivit la chute des pouvoirs aristocratiques comme le confirme ci-après Pélissier, parlant du phénomène.
« Ses caractéristiques les plus originaux tiennent à la présence de la confrérie, à l’encadrement qu’elle assure (…), au climat humain qu’elle fait régner, aux objectifs qu’elle assigne à ses adeptes. Face aux terres de l’Ouest occupées par des paysanneries enracinées, (…) mais brutalement décapitées à la fin du XIVème siècle ou progressivement privées de leurs cadres par l’évolution politiques et sociales des dernières décennies, les franges orientales du bassin de l’arachide offrent l’exemple d’une société puisant dans une interprétation originale de l’Islam les sources d’une organisation qui a renouvelé et décuplé le remarquable expansionnisme territorial manifesté par les wolofs au long de leur histoire. »
Enfin, la manière dont les mourides ont mis à profit l’avènement du rail témoigne de leur capacité à saisir toute opportunité que leur environnement leur offre.
Comme on le voit, sans le mouvement mouride, il aurait fallu inventer une solution pour réinsuffler aux peuples wolofs et sérères leur âme perdue dans le tumulte des péripéties de l’histoire précoloniale et coloniale.
DIOURBEL ET SON ARRIERE PLAN MYSTIQUE
Si la prise en compte de la dimension ésotérique est toujours nécessaire lorsqu’il s’agit d’analyser un phénomène religieux, elle s’avère indispensable lorsque le fait religieux en question concerne la vie et l’œuvre d’un homme de DIEU qui a proclamé haut et fort son statut de pôle chargé d’une mission divine : la revivification de l’Islam originel. Dans le cadre de cette contribution, on se contentera de montrer l’authenticité du sens mystique du retour du Cheikh à Diourbel.
Auparavant, voici le déroulement du déplacement historique du Cheikh tel qu’il a été rapporté par Serigne Amadou Lamine Diop Dagana dans son célèbre ouvrage « Irwa u nadîm »
On y trouve, dans le chapitre intitulé « Sa sortie du Jolof vers Njaareem », le passage ci-dessous :
« A l’aube du samedi 23 Muḥarram 1330, le Cheikh se dirigea vers Diourbel. Au bout de quelques « mètres », il s’arrêta pour effectuer la prière de ṣubh avant de reprendre sa marche en passant non loin de la ville de TOUBA. Il passa la nuit du dimanche 24 au lundi 25 Muharram à Ṭuubaa ALIMULKHABIR chez son disciple Cheikh Abdu Raḥmane LO, - lequel était chargé d’enseigner le Coran aux enfants du Cheikh, - avant de repartir très tôt le matin vers Diourbel où il passa la nuit du lundi 25 au mardi 26 Muharram (…). » (A. L. Diop)
« Râmû massîrî » : ou le triomphe d’un Jihadiste solitaire
L’évocation de l’étape de DIOUBEL en milieu mouride fait inéluctablement penser à « râmû massîrî » dont le contenu, aux accents de prophétie, suffit, à lui seul, pour nous inciter à sa commémoration cent ans après son avènement. En voici une ébauche de traduction.
« Ils ont sollicité mon déplacement vers Diourbel en 1330. S’ils avaient entrevu le secret de ce déplacement, jamais ils ne l’auraient provoqué. En réalité, ce transfert sonne le glas de ceux qui me haïssent et me persécutent, alors même que pour moi, il signifie pérennité et honneur. »
La formulation de la déclaration « râmû massîrî … (ils ont sollicité) » confirme un fait bien connu aujourd’hui des historiens : c’est bel et bien l’Autorité coloniale qui a pris l’initiative, de façon unilatérale, d’autoriser le Cheikh à s’installer à Diourbel.
Nous savons que c’est le commandant du cercle du Baol, qui, le premier, en 1908, avait sollicité le transfert du Cheikh en ces termes :
« Par mesure politique, j’ai l’honneur de vous demander de vouloir bien autoriser le cheikh Amadou Bamba à rentrer au Baol. Le marabout est actuellement dans le Djoloff (cercle de Louga) en résidence surveillée. Evidemment cheikh Amadou Bamba habiterait à Diourbel à côté de moi. » (O. Ba p. 139)
Cette première tentative du nouveau commandant de cercle n’aboutira pas. Le lieutenant Gouverneur, son supérieur, lui opposa un refus « au motif que le Baol était déjà un foyer bouillonnant d’islamisme et que la présence d’Ahmadou Bamba ne ferait qu’alourdir cette atmosphère de prosélytisme musulman.
Plus tard, en 1911, ce commandant obtint gain de cause grâce à l’appui du Directeur des affaires politiques selon qui, nous dit Babou,
« le déplacement du religieux vers sa terre natale était le seul moyen de contrer sa popularité et son influence grandissante, lesquelles étaient dues à son image de martyr et de victime de l’oppression . »
Aujourd’hui, il apparait clairement qu’au-delà de l’information qu’elle contient, « râmû massîrî » est en réalité une proclamation du Cheikh par laquelle il annonçait déjà l’échec inéluctable de ses ennemis dont il connaissait bien les desseins.
Mais pour quiconque « râmû massîrî » reste allégorique, il existe plusieurs passage dans ces écrits où le Cheikh nous fournit des indications sur les grandes étapes de son ascension spirituelle. Certains passages, comme celui que je résume ci-dessous, sont en des termes on ne peut plus clairs avec une chronologie précise qui confirme le statut spirituel de l’étape de Diourbel.
En effet, Boroom Tuubaa nous apprend que c’est Dieu LE-TRES-HAUT, qui lui a inspiré de faire allégeance au Prophète, paix et salut sur lui, en 1301, correspondant à 1883 ; de s’évertuer à lui dédier (PSL) un service exclusif, jusqu’en 1311 (1893) ; de sortir, par la suite, en 1313 (1895) pour effectuer son exil rempli de baraka et, pendant celui-ci, de se préoccuper de pratiquer le jihad contre l’âme charnelle, le Bas-monde, Satan et la Passion profane (…) jusqu’en 1330 (1912) et de s’appliquer, ensuite, à vouer de la Reconnaissance au SUBLIME, LE-TRES-HAUT, LE GLORIEUX ; avant de le faire triompher de son jihad contre la totalité de ses ennemis en 1332 (1914) »
Njaareem correspond donc à l’ultime étape de l’ascension spirituelle de notre Cheikh. Une étape qui marque la fin de son Jihad de l’âme survenue deux ans avant son triomphe total et définitif de tous ses ennemis. Après celui-ci, Sëriñ Tuubaa aura donc vécu treize années à Diourbel au milieu des disciples. On comprend dès lors toute la signification de « râmû massîrî » notamment dans sa dernière partie quand il dit, rappelons-le : « En réalité, ce transfert sonne le glas de ceux qui me haïssent et me persécutent, alors même que pour moi, il signifie pérennité et honneur. »
Comme on le voit donc si, sur le plan historique, l’installation de notre Guide dans le bourg de Diourbel, qui deviendra la deuxième ville mouride, lui a permis de réussir une éducation des masses mourides au sein même du système colonial, c’est parce que sur le plan mystique, il venait de boucler la boucle et de recevoir l’agrément divin à un niveau jamais égalé.
MEDITER L’EXEMPLE DE SËRIÑ TUUBAA POUR ……..
…Des stratégies de développement autocentrées s’appuyant sur des forces endogènes
De ce qui précède, il ressort clairement que si Sëriñ Tuubaa a su insuffler au Mouridisme un dynamisme et un esprit qui lui sont propres, ceux-ci ont été savamment déployés et mis en œuvre dans l’optique de renouveler et de décupler des potentialités de la société dans laquelle il vivait. Autrement dit, « la confrérie prête donc son efficacité et imprime sa marque à toute activité impliquant des adeptes. » (Mboup 2000)
Concevoir et formuler nos politiques publiques dans cette perspective, ce serait une belle manière de s’inspirer de l’exemple de Boroom Tuubaa.
…Un pacifisme total, doctrinal et sans ambigüité.
Dès la naissance de son mouvement, le fondateur du Mouridisme a systématiquement rejeté tout recours aux armes, se démarquant ainsi de ses prédécesseurs sénégalais qui avaient choisi de livrer bataille contre l’occupation coloniale et de pratiquer la guerre sainte contre les païens autochtones. Pourtant, la ruée des néophytes vers Ahmadou Bamba, parmi lesquels on comptait de nombreux aristocrates, était tellement importante que l’administration coloniale l’avait suspecté de vouloir lancer un Jihad et avait fini par procéder à son arrestation, avant de l’exiler au Gabon. Mais son pacifisme, parce que doctrinal, était sans ambigüité comme en témoigne un célèbre poème qu’il a rédigé pour réfuter les allégations de ses accusateurs, immortalisant ainsi son choix qu’il définit par opposition au Jihad armé. En substance, voici une traduction des passages les plus représentatifs du texte intégral :
« Vous m’avez déporté en m’accusant de préparer le Jihad… Vous prétendez que des armes sont en ma possession… Vos propos selon les lesquels je prône le Jihad sont certes vrais. Cependant, je fais du Jihad par le savoir et la crainte de Dieu… Le Sabre avec lequel je décapite les ennemis de Dieu est la proclamation de son Unicité…Mes canons sont le livre saint et ses versets…Les lances dont je dispose sont les Hadiths du Prophète….Les différentes branches des sciences religieuses sont autant de flèches acérées avec lesquelles je défends les traditions du Prophète…. Quant à celui qui m’espionne, je lui oppose un soufisme pur, clairement défini par de nobles gens ».
L’exemple du Cheikh montre bien que le pacifisme, loin d’empêcher le succès, en est un gage. Il a confié d’ailleurs à ses disciples une sagesse très éloquente à ce propos dont voici un résumé : « Kuy tooñ du mucc, kuy fayyu du ñong »
Par ces temps qui courent, même si nous décidions, nous sénégalais, de faire la sourde oreille, l’histoire semble nous interpeler par cette coïncidence que j’ai souhaité relayer dans le cadre de cette modeste contribution. Puisse ALLAH, PAR LA GRÂCE DU SERVITEUR DU PROPHETE NOUS LA COMPTER COMME UN BAKEELU AGREE EMANANT D’UN MOURIDE QUI ASPIRE A DEVENIR SAADIKH.
Mourtala Mboup, Consultant international, Genève, Suisse.
Dipl. Postgrade en Etudes du Développement
Dipl. Postgrade en Management et Analyse des Politiques Publiques
Licence en Sciences de l’Education
Ancien professeur de Mathématiques (CAE-CEM) à Dakar
calendrier grégorien
dimanche 1er février 2026 10:22 GMT
05e semaine, 31e jour de l'année

MEME RUBRIQUE
 En Direct Grand Théâtre - Concours Nafar Alquran 3eme Edition - Organiser Par Bachir Gueye Al Badri
En Direct Grand Théâtre - Concours Nafar Alquran 3eme Edition - Organiser Par Bachir Gueye Al Badri
En Direct Grand Théâtre - Concours Nafar Alquran 3eme Edition - Organiser Par Bachir Gueye Al Badri (vu 127 fois)
 Le discours historique de Serigne Abdoul Ahad Mbacke a Lambaye en 1982
Le discours historique de Serigne Abdoul Ahad Mbacke a Lambaye en 1982
Le discours historique de Serigne Abdoul Ahad Mbacke a Lambaye en 1982 (vu 322 fois)
 JOURNEE ZIKROULAH DECLARATION DU KHALIF GENERAL DES BAYE FALL SERIGNE AMDY KHADY FALL
JOURNEE ZIKROULAH DECLARATION DU KHALIF GENERAL DES BAYE FALL SERIGNE AMDY KHADY FALL
JOURNEE ZIKROULAH DECLARATION DU KHALIF GENERAL DES BAYE FALL SERIGNE AMDY KHADY FALL (vu 456 fois)
 NDIGUËL du Khalife Général des Mourides : Zikroulah et lecture du Coran le 26 et le 27 mai 2025
NDIGUËL du Khalife Général des Mourides : Zikroulah et lecture du Coran le 26 et le 27 mai 2025
NDIGUËL du Khalife Général des Mourides : Zikroulah et lecture du Coran le 26 et le 27 mai 2025 (vu 481 fois)
 NDIGUEUL de S. Mountakha Mbacke Journée Khassida -1er Mouharam 1447H - Appel de S. Hamsatou Mbacke
NDIGUEUL de S. Mountakha Mbacke Journée Khassida -1er Mouharam 1447H - Appel de S. Hamsatou Mbacke
Appel Serigne Hamsatou Mbacke Grand Journée Khassida sur recommandation du Khalife General des Mourides Serigne (…) (vu 444 fois)
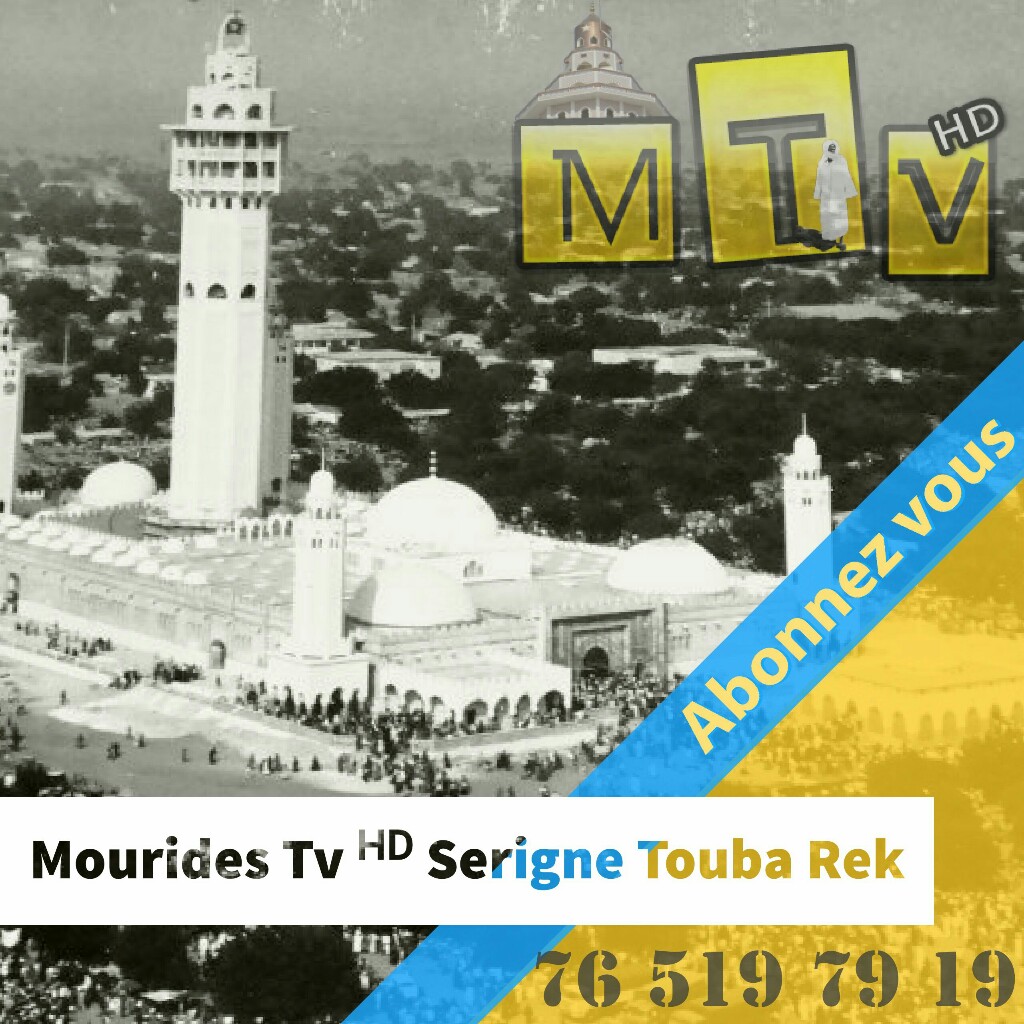
Les derniers articles
 Place de la Femme Dans l’islam
Place de la Femme Dans l’islam
Certes, les exemples de femmes vertueuses, méritoires et dont la vie est très édifiante aux yeux de l’Islam sont (…)
 La vie et l’œuvre de Sokhna Diarra BOUSSO
La vie et l’œuvre de Sokhna Diarra BOUSSO
I- QUI EST SOKHNA DIARRA A - Généalogie De son vrai nom Mariama Bousso, elle nous est parvenue en 1833 à (…)
 L’œuvre agréée de Sokhna Diarra BOUSSO
L’œuvre agréée de Sokhna Diarra BOUSSO
A quelque aspect de sa vie qu’on puisse s’intéresser (vie de croyante, vie d’épouse, vie de mère), force est de (…)
 Apercu Sur la Ville de Porokhane
Apercu Sur la Ville de Porokhane
Située à quelques encablures de la frontière gambienne, Porokhane n’est séparée du chef lieu départemental NIORO DU (…)
 Mame Diarra Bousso : Référence de la femme vertueuse
Mame Diarra Bousso : Référence de la femme vertueuse
Originaire de la famille des " Mboussobé " d’illustres lettrés imbus des valeurs cardinales islamiques Sayidatunâ (…)
Calendrier Musulman
 Le premier jour du mois lunaire de Muharram 1446H. correspond au Lundi 08 Juillet 2024
Le premier jour du mois lunaire de Muharram 1446H. correspond au Lundi 08 Juillet 2024
NB : Muharram est le premier mois du calendrier hégirien qui marque le début du nouvel an musulman 1446. (…) 1236 vues
 Le premier jour du mois lunaire de Jumâdal Ûlâ 1445 H. Correspond Mercredi 15 Novembre 2023
Le premier jour du mois lunaire de Jumâdal Ûlâ 1445 H. Correspond Mercredi 15 Novembre 2023
Le premier jour du mois lunaire de Jumâdal Ûlâ 1445 H. جمادى الأولى Correspond au Mercredi 15 Novembre 2023 NB : (…) 31083 vues
 Le premier jour du mois lunaire de Rabi-ul Awwal 1444H. correspond au mercredi 28 septembre 2022
Le premier jour du mois lunaire de Rabi-ul Awwal 1444H. correspond au mercredi 28 septembre 2022
La Naissance du Prophète Mouhammad (Paix et Salut sur Lui) communément appelée Mawlûd dans le monde Musulman survint (…) 18636 vues
TENDANCE DU JOUR
 Jazbul Quluub ila Allâmil Ghuyûb " (L’attirance des Cœurs Vers le Connaisseur des Mystères) Khassida écrit par Cheikhouna Cheikh Ahmadou Bamba
Jazbul Quluub ila Allâmil Ghuyûb " (L’attirance des Cœurs Vers le Connaisseur des Mystères) Khassida écrit par Cheikhouna Cheikh Ahmadou Bamba
Au NOM de DIEU, le CLEMENT, le MISERICORDIEUX 1. Gloire à la VERITE, manifeste [DIEU], LUI Dont la Disponibilité (…) 100 %
 AL-Mashrabu Shafi Ramadan 2024 - 1445H الْمَشْرَبُ الصًافِي مِنَ الْمَنْبَعِ الشًافِي : Hizbut Tarqiyyah a la Résidence Cheikhoul Khadim de Touba (…)
AL-Mashrabu Shafi Ramadan 2024 - 1445H الْمَشْرَبُ الصًافِي مِنَ الْمَنْبَعِ الشًافِي : Hizbut Tarqiyyah a la Résidence Cheikhoul Khadim de Touba (…)
AL-Mashrabu Shafi Ramadan 2024 - 1445H الْمَشْرَبُ الصًافِي مِنَ الْمَنْبَعِ الشًافِي : Hizbut Tarqiyyah a la (…) 64 %
 Cheikh Sidy al Moukhtar MBACKE (2010 2018)
Cheikh Sidy al Moukhtar MBACKE (2010 2018)
Cheikh Sidi Moukhtar Mbacké réputé comme étant un homme ouvert à la discussion tout en affichant son attachement à (…) 48 %
 Ecouter et Télécharger les Khassaides de Serigne Touba (KUREL)
Ecouter et Télécharger les Khassaides de Serigne Touba (KUREL)
De son vrai nom Mouhamad ben Mouhamad ben Habîballâh , CHEIKH AHMADOU BAMBA nous parvint par la grâce de DIEU au (…) 15 %
 Le Calendrier des Magal : des Dates a ne pas Oublier !!!
Le Calendrier des Magal : des Dates a ne pas Oublier !!!
NAISSANCE DU PHOPHETE MOHAMED : Jour de Lundi au matin du troisième mois de l’année musulmane (Rabioulawal) 12iéme (…) 12 %
 Écouter et Télécharger les Khassaides de Serigne Touba (RADIASS)
Écouter et Télécharger les Khassaides de Serigne Touba (RADIASS)
En introduisant la plupart de ses ouvrages sur les Sciences Religieuses, l’Auteur, en l’occurrence CHEIKH AHMADOU (…) 8 %
 Forum Islamique : Discours de Ahmad Ould Daoud Ministre Mauritanien chargé des affaires Islamique et de l’enseignement original
Forum Islamique : Discours de Ahmad Ould Daoud Ministre Mauritanien chargé des affaires Islamique et de l’enseignement original
Forum Islamique : Discours de Ahmad Ould Daoud Ministre Mauritanien chargé des affaires Islamique et de (…) 7 %
 SOKHNA MAIMOUNA MBACKE : la gardienne des valeurs et des vertus
SOKHNA MAIMOUNA MBACKE : la gardienne des valeurs et des vertus
SOKHNA MAIMOUNA MBACKE : la gardienne des valeurs et des vertus Fille cadette de Cheikh Ahmadou Bamba, le (…) 6 %
 RAMADAN 1446H-2025 Hizbut Tarqiyyah : AL-Mashrabu Shafi - الْمَشْرَبُ الصًافِي مِنَ الْمَنْبَعِ الشًافِي - (MP3)
RAMADAN 1446H-2025 Hizbut Tarqiyyah : AL-Mashrabu Shafi - الْمَشْرَبُ الصًافِي مِنَ الْمَنْبَعِ الشًافِي - (MP3)
RAMADAN 1446H-2025 Hizbut Tarqiyyah : AL-Mashrabu Shafi - الْمَشْرَبُ الصًافِي مِنَ الْمَنْبَعِ الشًافِي - Résidence (…) 6 %
AL-Mashrabu Shafi Hizbut Tarqiyyah Ramadan 2025-1446H
Playlist
-
J01 CHAHRU RAMADAN HT KUREL NURUD DARAYNI HT TOUBA Télécharger -
J01 HUZUBIRABIKUM S SYLLA KUREL NURUD DARAYNI HT TOUBA Télécharger - MP3 - 9.1 Mio
-
J01 MINANU BAQILKHADIM S MB DIAKHATE KUREL NURUD DARAYNI HT TOUBA Télécharger - MP3 - 49.8 Mio
-
J01 YAKHAYRA DAYFI WKSM KUREL NURUD DARAYNI HT TOUBA Télécharger - MP3 - 6.7 Mio
-
J02 BISMILLAHILAZI WKSM KUREL MAFATIHUL BICHRI HT TOUBA Télécharger - MP3 - 8.7 Mio
-
J02 MINAL KHADIMI S MB DIOP KUREL MAFATIHUL BICHRI HT TOUBA Télécharger - MP3 - 22.2 Mio
-
J02 WAQANI S A KH SEYE KUREL MAFATIHUL BICHRI HT TOUBA Télécharger - MP3 - 8 Mio
-
J02 YAKHAYRA DAYFI S M NIASS KUREL MAFATIHUL BICHRI HT TOUBA Télécharger - MP3 - 7.1 Mio
-
J02 YAQULUMAN S TAFSIR DIOP KUREL MAFATIHUL BICHRI HT TOUBA Télécharger - MP3 - 16.2 Mio
-
J03 AHMADU MUHNIYAN S TAFSIR DIOP KUREL NURUD DARAYNI HT THIES Télécharger - MP3 - 14.7 Mio
-
J03 BIKHAQI S M SY KUREL NURUD DARAYNI HT THIES Télécharger - MP3 - 2 Mio
-
J03 HAMMAD SULEYMA S M DIOP KUREL NURUD DARAYNI HT THIES Télécharger - MP3 - 45.4 Mio
-
J03 WADIABA S MODOU DIOP KUREL NURUD DARAYNI HT THIES Télécharger - MP3 - 10.8 Mio
-
J04 JAZBU S M GUEYE KUREL SERIGNE MAHIB HT Télécharger - MP3 - 80.3 Mio
-
J05 AHBABTU-FATAHA WKSM KUREL NURUD DARAYNI HT DAKAR Télécharger - MP3 - 15.1 Mio
-
J05 LAACHAKA S MBAYE DIOP KUREL NURUD DARAYNI HT DAKAR Télécharger - MP3 - 36.8 Mio
-
J05 MATLABUCHIFAHI-INALLAHA CHAMIHUN S TAFSIR DIOP KUREL NURUD DARAYNI HT DAKAR Télécharger - MP3 - 11.1 Mio
-
J05 YAZALWUDIOUDI S ABDOU DIOP KUREL NURUD DARAYNI HT DAKAR Télécharger - MP3 - 4.8 Mio
-
J06 MOUKHADAMUTUS CHUHRAA S MB DIOP KUREL SERIGNE ABDOU LAHAD HT Télécharger - MP3 - 70.8 Mio
-
J07 CHAHRU RAMADAN S B SENE KUREL NURUD DARAYNI HT RUFISQUE Télécharger - MP3 - 3.6 Mio
-
J07 MAWAHIBU S MBACKE DIAGNE KUREL NURUD DARAYNI HT RUFISQUE Télécharger - MP3 - 58.5 Mio
-
J07 WADIAHTU LAHI HAMDAN S CISSE KUREL NURUD DARAYNI HT RUFISQUE Télécharger - MP3 - 7.6 Mio
-
J08 AJABANI RABUSSAMA S A KH GASSAMA KUREL WAKEUR SERIGNE MASSAMBA HT Télécharger - MP3 - 16.7 Mio
-
J08 LIMAHINE S CISSE KUREL WAKEUR SERIGNE MASSAMBA HT Télécharger - MP3 - 52.4 Mio
-
J08 RABI WKSM KUREL WAKEUR SERIGNE MASSAMBA HT Télécharger - MP3 - 5.1 Mio
-
J09 BISMILAHI IKFINI WKSM KUREL NURUD DARAYNI HT MBACKE Télécharger - MP3 - 41.8 Mio
-
J09 FATHUL MUKARIM S TAFSIR DIOP KUREL NURUD DARAYNI HT MBACKE Télécharger - MP3 - 11.6 Mio
-
J09 MADALKHABIRU DARU MINAM KUREL NURUD DARAYNI HT MBACKE Télécharger - MP3 - 4.7 Mio
-
J09 WAZKURULAHI S CISSE KUREL NURUD DARAYNI HT MBACKE Télécharger - MP3 - 13 Mio
-
J10 BAARAKALIN NAAFIHU S M L GUEYE KUREL MACHRABUS CHAFI HT Télécharger - MP3 - 3.3 Mio
-
J10 FATHUL FATTAH S TAFSIR DIOP KUREL MACHRABUS CHAFI HT Télécharger - MP3 - 29 Mio
-
J10 MACHRABUS CHAFI S M DIOP KUREL MACHRABUS CHAFI HT Télécharger - MP3 - 15.7 Mio
-
J10 MADALIYAL MADADTU WKSM KUREL MACHRABUS CHAFI HT Télécharger - MP3 - 14 Mio
-
J10 YAKHAYRA WKSM WKSM KUREL MACHRABUS CHAFI HT Télécharger - MP3 - 6.2 Mio
-
J11 BISMILAHILAZI S CISSE KUREL MAFATIHUL BICHRI HT DAKAR Télécharger - MP3 - 9 Mio
-
J11 LAMYANKHU S TAFSIR DIOP KUREL MAFATIHUL BICHRI HT DAKAR Télécharger - MP3 - 16.4 Mio
-
J11 MAFATIHUL DJINANE S MAHIB GUEYE KUREL MAFATIHUL BICHRI HT DAKAR Télécharger - MP3 - 29.2 Mio
-
J11 RADITU S MBAYE DIOP KUREL MAFATIHUL BICHRI HT DAKAR Télécharger - MP3 - 18.2 Mio
-
J12 BUCHRA-YARABIBILMOUSTAPHA WKSM KUREL SERIGNE SALIOU HT Télécharger - MP3 - 14.5 Mio
-
J12 CHAHIDALI S M L GUEYE KUREL SERIGNE SALIOU HT Télécharger - MP3 - 3.5 Mio
-
J12 INNANI HOUZTU S BOLLE MBAYE KUREL SERIGNE SALIOU HT Télécharger - MP3 - 17.6 Mio
-
J12 LIRABINE S A FALL KUREL SERIGNE SALIOU HT Télécharger - MP3 - 15.6 Mio
-
J12 MOUDDAKHAYAATI S M SY KUREL SERIGNE SALIOU HT Télécharger - MP3 - 2.4 Mio
-
J12 WAKANA S TAFSIR DIOP KUREL SERIGNE SALIOU HT Télécharger - MP3 - 23.7 Mio
-
J13 ALHAMDULILLAHI-YAMUKRIMA WKSM KUREL NURUD DARAYNI HT TIVAOUANE Télécharger - MP3 - 20.1 Mio
-
J13 ALLAHU KHILIYA-MANZANANI S ABDOU DIOP KUREL NURUD DARAYNI HT TIVAOUANE Télécharger - MP3 - 6.7 Mio
-
J13 HAMIDTU S IBRAHIMA LO KUREL NURUD DARAYNI HT TIVAOUANE Télécharger - MP3 - 5.6 Mio
-
J13 LIYANKHADA-RAFAHNA-MADAHTUN-YASSURU S MAHIB GUEYE KUREL NURUD DARAYNI HT TIVAOUANE Télécharger - MP3 - 22.2 Mio
-
J13 WAQUL JAA ALKHAQU S CISSE KUREL NURUD DARAYNI HT TIVAOUANE Télécharger - MP3 - 16.9 Mio
-
J14 FARIHA WKSM KUREL NURUD DARAYNI HT TOUBA Télécharger - MP3 - 7.6 Mio
-
J14 FAZAT S MODOU THIAM KUREL NURUD DARAYNI HT TOUBA Télécharger - MP3 - 7.1 Mio
-
J14 MATLABU FAWZAYNI S M L GUEYE KUREL NURUD DARAYNI HT TOUBA Télécharger - MP3 - 55.6 Mio
-
J14 WADIABA S ABDOU DIOP KUREL NURUD DARAYNI HT TOUBA Télécharger - MP3 - 5.5 Mio
-
J15 HUQQA S M DIOP KUREL NURUD DARAYNI HT MBOUR Télécharger - MP3 - 31.9 Mio
-
J15 TAYSIRUL ASSIR S T DIOP KUREL NURUD DARAYNI HT MBOUR Télécharger - MP3 - 45 Mio
-
J16 ALLAHU BARRUN-WADIEUHTULAHI S CISSE KUREL MAFATIHUL BICHRI HT RUFISQUE Télécharger - MP3 - 15.6 Mio
-
J16 KHADTAABA WKSM KUREL MAFATIHUL BICHRI HT RUFISQUE Télécharger - MP3 - 38.1 Mio
-
J16 SINDIDI S M DIOP KUREL MAFATIHUL BICHRI HT RUFISQUE Télécharger - MP3 - 21.1 Mio
-
J17 JAZBU WKSM KUREL ASNA KHADIM HT Télécharger - MP3 - 81.9 Mio
-
J17 MINAL ILAAHI S TAFSIR DIOP KUREL ASNA KHADIM HT Télécharger - MP3 - 9.8 Mio
-
J18 ANTA RABBI DAROU MOUHTY KUREL MAFATIHUL BICHRI HT TOUBA Télécharger - MP3 - 8.8 Mio
-
J18 LIYAHLAMA S M SY KUREL MAFATIHUL BICHRI HT TOUBA Télécharger - MP3 - 5.8 Mio
-
J18 MIDADI S MAHIB GUEYE KUREL MAFATIHUL BICHRI HT TOUBA Télécharger - MP3 - 26 Mio
-
J18 RADITOU S A FALL KUREL MAFATIHUL BICHRI HT TOUBA Télécharger - MP3 - 24.8 Mio
-
J18 WADUDU S DIOKHANE KUREL MAFATIHUL BICHRI HT TOUBA Télécharger - MP3 - 6.4 Mio
-
J19 AJABANI S MBAYE DIOP KUREL SERIGNE MAHIB HT Télécharger - MP3 - 13.2 Mio
-
J19 AJABANI-ZIYARATUN S CISSE KUREL SERIGNE MAHIB HT Télécharger - MP3 - 5.8 Mio
-
J19 LIMAHINE S MAHIB GUEYE KUREL SERIGNE MAHIB HT Télécharger - MP3 - 46.6 Mio
-
J19 YARRABILMUSTAPHA WKSM KUREL SERIGNE MAHIB HT Télécharger - MP3 - 3.9 Mio
-
J20 ALAA INANI HUZNY S MB DIOP KUREL SERIGNE ABDOU LAHAD HT Télécharger - MP3 - 9.5 Mio
-
J20 BUSHRA-RABBI WKSM KUREL SERIGNE ABDOU LAHAD HT Télécharger - MP3 - 17.5 Mio
-
J20 CHUKURY S M KEBE KUREL SERIGNE ABDOU LAHAD HT Télécharger - MP3 - 4.7 Mio
-
J20 FAJAA ANI S IBRAHIMA LO KUREL SERIGNE ABDOU LAHAD HT Télécharger - MP3 - 10.5 Mio
-
J20 HALAMAN S A KH SEYE KUREL SERIGNE ABDOU LAHAD HT Télécharger - MP3 - 10.5 Mio
-
J20 KHUDA ILAA WKSM KUREL SERIGNE ABDOU LAHAD HT Télécharger - MP3 - 7.7 Mio
-
J20 MADALKHABIRU-LISSANUCHUKRY WAKEUR S BASSIROU KUREL SERIGNE ABDOU LAHAD HT Télécharger - MP3 - 10.4 Mio
-
J20 ZALAT S MASSAMBA NIASS KUREL SERIGNE ABDOU LAHAD HT Télécharger - MP3 - 5.7 Mio
-
J21 ALAL MOUNTAKHA KHAYRIL KUREL NÛRU DÂRAYNI HT THIES Télécharger - MP3 - 5.2 Mio
-
J21 CHAHRU SIYAMI KUREL NÛRU DÂRAYNI HT THIES Télécharger - MP3 - 5 Mio
-
J21 TOUHFATOUL MOUTADARRIHINA KUREL NÛRU DÂRAYNI HT THIES Télécharger - MP3 - 6.2 Mio
-
J21 WAJAHTOU KULLIYA ZA KUREL NÛRU DÂRAYNI HT THIES Télécharger - MP3 - 5 Mio
-
J21 WAQUL DIA AL HAQQU KUREL NÛRU DÂRAYNI HT THIES Télécharger - MP3 - 10.7 Mio
-
J22 BISMILAHI IKFINI KUREL SERIGNE SALIOU MBACKE HT Télécharger - MP3 - 27.4 Mio
-
J22 CHAKAWTU KUREL SERIGNE SALIOU MBACKE HT Télécharger - MP3 - 3.1 Mio
-
J22 FAZAL LAZINA HAFASO KUREL SERIGNE SALIOU MBACKE HIZBU TARQIYYAH Télécharger - MP3 - 2.1 Mio
-
J22 WAJAHTU WAJHIYA ZA KUREL SERIGNE SALIOU MBACKE HIZBU TARQIYYAH Télécharger - MP3 - 7.4 Mio
-
J22 YAMAN BI AMDAHI KUREL SERIGNE SALIOU MBACKE HIZBU TARQIYYAH Télécharger - MP3 - 2.3 Mio
-
J23 FUZTY WKSM KUREL SERIGNE MASSAMBA MBACKE HT Télécharger - MP3 - 5.4 Mio
-
J23 MAWAHIBOU WKSM KUREL SERIGNE MASSAMBA MBACKE HT Télécharger - MP3 - 43.5 Mio
-
J23 SHAKURU RAFIHU WKSM KUREL SERIGNE MASSAMBA MBACKE HT Télécharger - MP3 - 3.2 Mio
-
J24 MUXADIMAATUL AMDAH WKSM KUREL NURUD DARAYNI TOUBA HT Télécharger - MP3 - 86.6 Mio
-
J25 RUMNAA SÑ CISSÉ KUREL SERIGNE ABDU LAHAT MBACKEHT Télécharger - MP3 - 25.7 Mio
-
J25 WA HANYMUSTAFAA SÑ TAFSIR KUREL S ABDU LAHAT MBACKE HT Télécharger - MP3 - 5.5 Mio
-
J25 YAA ZAL BUSHARAATI KUREL SERIGNE ABDU LAHAT MBACKE HT Télécharger - MP3 - 17.7 Mio
-
J26 ANABTU ILAL BAQI SÑ TAFSIR KUREL NURUD DARAYNI RUFISQUE HT Télécharger - MP3 - 5.5 Mio
-
J26 MADHUN NABIYYAL MOUNTAKHA KUREL NURUD DARAYNI RUFISQUE HT Télécharger - MP3 - 2.1 Mio
-
J26 MINANUL BAQQIL XADIIM KUREL NURUD DARAYNI RUFISQUE HT Télécharger - MP3 - 29.2 Mio
-
J26 YAA ZAL BUSHARAATI KUREL NURUD DARAYNI RUFISQUE HT Télécharger - MP3 - 16.8 Mio
-
J27 WALAQAD KARAMNA S CISSE KUREL MACHRABUS CHAFI HT Télécharger - MP3 - 37.2 Mio
-
J27 YAAZALBUSHARATY-RABBI WKSM KUREL MACHRABUS CHAFI HT Télécharger - MP3 - 28.8 Mio
-
J27 YASSURU-INNAWUJUDU S MBAYE DIOP KUREL MACHRABUS CHAFI HT Télécharger - MP3 - 11.9 Mio
-
J28 BUSHRA DAROU MOUHTY KUREL NURUD DARAYNI HT DAKAR Télécharger - MP3 - 11.6 Mio
-
J28 LAMYABDU-CHAHRU RAMADAN S M SY KUREL NURUD DARAYNI HT DAKAR Télécharger - MP3 - 8.8 Mio
-
J28 MATLABU FAWZAYNI S DIOKHANE KUREL NURUD DARAYNI HT DAKAR Télécharger - MP3 - 47 Mio
-
J28 WAQANI WKSM KUREL NURUD DARAYNI HT DAKAR Télécharger - MP3 - 8.6 Mio
-
J29 AHBABTU WKSM KUREL ASNAL KHADIM HT Télécharger - MP3 - 7.4 Mio
-
J29 FARIJ HT KUREL ASNAL KHADIM HT Télécharger - MP3 - 3 Mio
-
J29 LAMYABDU-FAZALAZI S M SY KUREL ASNAL KHADIM HT Télécharger - MP3 - 8.3 Mio
-
J29 MAWAHIBU WKSM KUREL ASNAL KHADIM HT Télécharger - MP3 - 63.1 Mio
 Mourides Tv HD Serigne Touba Rek - L’actualité du Mouridisme
Mourides Tv HD Serigne Touba Rek - L’actualité du Mouridisme

